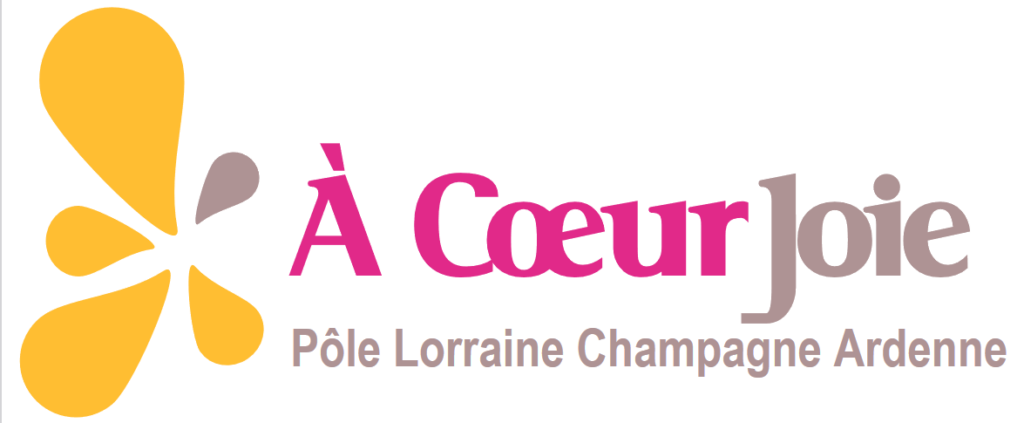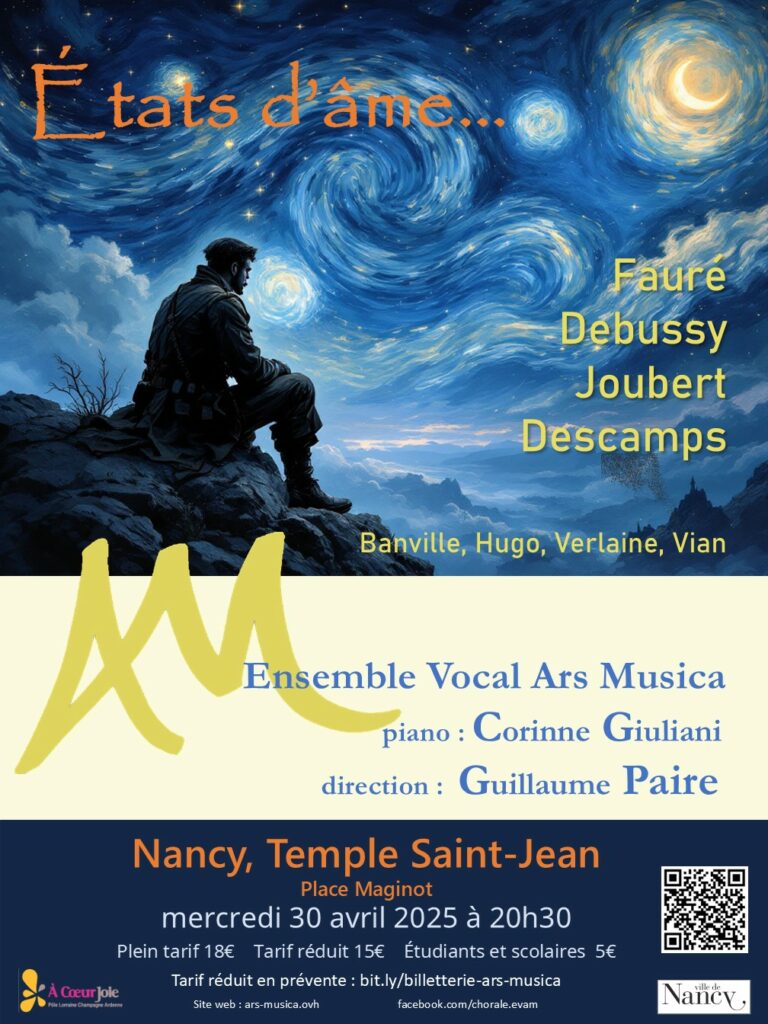
Direction musicale Guillaume Paire
États d’âme…
1ère partie
Ouverture
Poème : L’Evadé (Boris Vian)
Acte I
Les amours défunts
Nuit d’étoiles (Cl. Debussy sur un poème de Th. de Banville)
Acte II
Une sourde menace
Poème : Clair de lune (V.Hugo) (3 premières strophes)
Les Djinns (G.Fauré sur un poème de V.Hugo)
Acte III
L’absurde sacrifice
Poème : À tous les enfants (B.Vian) (1ère partie)
Les Chants d’Argonne (poème et musique de Pascal Descamps)
- Dimanche 2 août 1914
- Les forêts d’Argonne
- L’adieu…
2ème partie
Ariettes oubliées (Julien Joubert sur un texte de Paul Verlaine)
I Le vent dans la plaine
II Je devine à travers un murmure
III Il pleure dans mon cœur
IV Il faut, voyez-vous, nous pardonner les choses
V Le piano que baise une main frêle
VI C’est le chien de Jean de Nivelle
VII Ô triste triste était mon âme
VIII Dans l’interminable /Ennui de la plaine
IX L’ombre des arbres dans la rivière embrumée
« Défense de déposer de la musique au pied de mes vers… »
C’est ainsi que Victor Hugo, sur un ton rageur et ombrageux, aurait interdit de son temps que l’on mît ses poèmes en musique, craignant sans doute que sa parole poétique perde alors de sa vigueur et de son authenticité. Il faudra attendre quelques décennies, une fois que la mélodie française aura trouvé son identité face au lied romantique, pour que les compositeurs s’intéressent véritablement à la poésie. Ainsi, bravant l’interdit hugolien, Gabriel Fauré met en musique en 1875 le poème intitulé « Les Djinns », séduit par sa forme expressive et son propos dramatique.
Murs, ville,
Et port.
Asile
De mort,
Mer grise
Où brise
La brise,
Tout dort.
Dans la plaine
Naît un bruit.
C’est l’haleine
De la nuit.
Elle brame
Comme une âme
Qu’une flamme
Toujours suit.
La voix plus haute
Semble un grelot.
D’un nain qui saute
C’est le galop.
Il fuit, s’élance,
Puis en cadence
Sur un pied danse
Au bout d’un flot.
La rumeur approche,
L’écho la redit.
C’est comme la cloche
D’un couvent maudit ;
Comme un bruit de foule,
Qui tonne et qui roule,
Et tantôt s’écroule,
Et tantôt grandit.
Dieu ! la voix sépulcrale
Des Djinns !… Quel bruit ils font !
Fuyons sous la spirale
De l’escalier profond.
Déjà s’éteint ma lampe,
Et l’ombre de la rampe,
Qui le long du mur rampe,
Monte jusqu’au plafond. (…)
Cris de l’enfer ! Voix qui hurle et qui pleure !
L’horrible essaim, poussé par l’aquilon,
Sans doute, ô ciel ! s’abat sur ma demeure.
Le mur fléchit sous le noir bataillon.
La maison crie et chancelle penchée,
Et l’on dirait que, du sol arrachée,
Ainsi qu’il chasse une feuille séchée,
Le vent la roule avec leur tourbillon !
Prophète ! Si ta main me sauve
De ces impurs démons des soirs,
J’irai prosterner mon front chauve
Devant tes sacrés encensoirs !
Fais que sur ces portes fidèles
Meure leur souffle d’étincelles,
Et qu’en vain l’ongle de leurs ailes
Grince et crie à ces vitraux noirs ! (…)
De leurs ailes lointaines
Le battement décroît,
Si confus dans les plaines,
Si faible, que l’on croit
Ouïr la sauterelle
Crier d’une voix grêle,
Ou pétiller la grêle
Sur le plomb d’un vieux toit. (…)
Les Djinns funèbres,
Fils du trépas,
Dans les ténèbres
Pressent leurs pas ;
Leur essaim gronde :
Ainsi, profonde,
Murmure une onde
Qu’on ne voit pas.
Ce bruit vague
Qui s’endort,
C’est la vague
Sur le bord ;
C’est la plainte,
Presque éteinte,
D’une sainte
Pour un mort.
On doute
La nuit…
J’écoute : —
Tout fuit,
Tout passe ;
L’espace
Efface
Le bruit.
« Les Djinns », extrait de « Les Orientales », Victor Hugo (1829)
N.B. :
Gabriel Fauré n’a pas mis en musique toutes les strophes de la poésie de Victor Hugo. Le signe (…) indique les coupures par rapport au texte original.
Mais la musique française entend bien s’affranchir de la poésie visionnaire et emphatique du patriarche Hugo pour s’intéresser à celle de Baudelaire (« La musique parfois me prend comme une mer… ») et surtout celle de Verlaine, poète de l’ellipse, de la concision et de la nuance. Après Debussy en 1886, Julien Joubert (né en 1973) met en musique les « Ariettes oubliées » en 1997, neuf courtes pièces ciselées comme autant de petits diamants dont la musicalité et la légèreté illustrent à merveille la profession de foi du poète maudit exprimée dans son « Art Poétique » :
« De la musique avant toute chose
Et pour cela préfère l’impair
Plus vague et plus soluble dans l’air
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose… »
Les « Ariettes oubliées » de Verlaine ont été écrites en 1872 lors de son exil volontaire en Belgique puis en Angleterre, en compagnie de Rimbaud ; et leur tonalité pose question : s’agit-il d’une demande de pardon et de réconciliation auprès de Mathilde, l’épouse délaissée, ou de l’éloge voilé de cette volupté nouvelle, ou bien encore de l’angoisse générée par ce nouveau choix de vie ? C’est sans doute cette dernière hypothèse qu’a retenue Julien Joubert à l’âge de 24 ans : « J’ai senti que si j’avais le talent de Verlaine (…) j’aurais écrit exactement cela (…) ce fait de savoir si la vie qu’on a choisie est la bonne ou pas, quand on a environ vingt ans, ce sont des questions que l’on peut se poser… »
Ariettes oubliées (Paul Verlaine)
I
« Le vent dans la plaine/Suspend son haleine » (Favart)
C’est l’extase langoureuse.
C’est la fatigue amoureuse ,
C’est tous les frissons des bois
Parmi l’étreinte des brises,
C’est, vers les ramures grises,
Le chœur des petites voix.
Ô le frêle et frais murmure !
Cela gazouille et susurre,
Cela ressemble au cri doux
Que l’herbe agitée expire…
Tu dirais, sous l’eau qui vire.
Le roulis sourd des cailloux.
Cette âme qui se lamente
En cette plainte dormante
C’est la nôtre, n’est-ce pas?
La mienne, dis, et la tienne.
Dont s’exhale l’humble antienne
Par ce tiède soir, tout bas ?
II
Je devine, à travers un murmure.
Le contour subtil des voix anciennes
Et dans les lueurs musiciennes.
Amour pâle, une aurore future !
Et mon âme et mon cœur en délires
Ne sont plus qu’une espèce d’œil double
Où tremblote à travers un jour trouble
L’ariette, hélas ! de toutes lyres !
Ô mourir de cette mort seulette
Que s’en vont, — cher amour qui t’épeures.
Balançant jeunes et vieilles heures !
Ô mourir de cette escarpolette !
III
« Il pleut doucement sur la ville » (Rimbaud)
II pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville :
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon cœur ?
Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits !
Pour un cœur qui s’ennuie
Ô le chant de la pluie !
Il pleure sans raison
Dans ce cœur qui s’écœure.
Quoi ! nulle trahison ?…
Ce deuil est sans raison.
C’est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon cœur a tant de peine !
IV
« De la douceur, de la douceur, de la douceur. » (inconnu.)
II faut, voyez-vous, nous pardonner les choses.
De cette façon nous serons bien heureuses.
Et si notre vie a des instants moroses.
Du moins nous serons, n’est-ce pas ? deux pleureuses.
Ô que nous mêlions, âmes sœurs que nous sommes,
A nos vœux confus la douceur puérile
De cheminer loin des femmes et des hommes.
Dans le frais oubli de ce qui nous exile !
Soyons deux enfants, soyons deux jeunes filles
Éprises de rien et de tout étonnées,
Qui s’en vont pâlir sous les chastes charmilles
Sans même savoir qu’elles sont pardonnées.
V.
« Son joyeux, importun d’un clavecin sonore. » (Pétrus Borel.)
Le piano que baise une main frêle
Luit dans le soir rose et gris, vaguement,
Tandis qu’avec un très léger bruit d’aile
Un air bien vieux, bien faible et bien charmant
Rôde discret, épeuré quasiment,
Par le boudoir longtemps parfumé d’Elle .
Qu’est-ce que c’est que ce berceau soudain
Qui lentement dorlote mon pauvre être ?
Que voudrais-tu de moi, doux chant badin ?
Qu’as-tu voulu, fin refrain incertain
Qui va bientôt mourir vers la fenêtre
Ouverte un peu sur le petit jardin ?
VI
C’est le chien de Jean de Nivelle
Qui mord sous l’œil même du guet
Le chat de la mère Michel.
François-les-bas-bleus s’en égaie.
La Lune à l’écrivain public
Dispense sa lumière obscure
Où Médor avec Angélique
Verdissent sur le pauvre mur.
Et voici venir la Ramée
Sacrant, en bon soldat du Roy.
Sous son habit blanc mal famé.
Son cœur ne se tient pas de joie :
Car la boulangère… — Elle ? — Oui dam !
Bernant Lustucru, son vieil homme,
A tantôt couronné sa flamme…
Enfants, Dominus vobiscum.
Place ! En sa longue robe bleue
Toute en satin qui fait frou-frou,
C’est une impure, palsambleu !
Dans sa chaise qu’il faut qu’on loue.
Fût-on philosophe ou grigou,
Car tant d’or s’y relève en bosse
Que ce luxe insolent bafoue
Tout le papier de Monsieur Loss !
Arrière, robin crotté ! place.
Petit courtaud, petit abbé.
Petit poète jamais las
De la rime non attrapée ! …
Voici que la nuit vraie arrive …
Cependant jamais fatigué
D’être inattentif et naïf,
François-les-bas-bleus s’en égaie.
VII
Ô triste, triste était mon âme
À cause, à cause d’une femme.
Je ne me suis pas consolé
Bien que mon cœur s’en soit allé,
Bien que mon cœur, bien que mon âme
Eussent fui loin de cette femme.
Je ne me suis pas consolé,
Bien que mon cœur s’en soit allé.
Et mon cœur, mon cœur trop sensible
Dit à mon âme : Est-il possible,
Est-il possible, – le fût-il, –
Ce fier exil, ce triste exil ?
Mon âme dit à mon cœur : Sais-je
Moi-même que nous veut ce piège
D’être présents bien qu’exilés,
Encore que loin en allés ?
VIII
Dans l’interminable
Ennui de la plaine,
La neige incertaine
Luit comme du sable.
Le ciel est de cuivre
Sans lueur aucune.
On croirait voir vivre
Et mourir la lune.
Comme des nuées
Flottent gris les chênes
Des forêts prochaines
Parmi les buées.
Le ciel est de cuivre
Sans lueur aucune.
On croirait voir vivre
Et mourir la lune .
Corneille poussive
Et vous, les loups maigres,
Par ces bises aigres
Quoi donc vous arrive ?
Dans l’interminable
Ennui de la plaine
La neige incertaine
Luit comme du sable.
IX.
« Le rossignol qui du haut d’une branche se regarde dedans, croit être tombé dans la rivière. Il est au sommet d’un chêne et toutefois il a peur de se noyer. » (Cyrano de Bergerac XVIIème.)
L’ombre des arbres dans la rivière embrumée
Meurt comme de la fumée
Tandis qu’en l’air, parmi les ramures réelles,
Se plaignent les tourterelles.
Combien, ô voyageur, ce paysage blême
Te mira blême toi-même,
Et que tristes pleuraient dans les hautes feuillées
Tes espérances noyées !
Éléments d’interprétation
Contexte. Ces neuf poèmes constituent la première section des Romances sans paroles (1874) et furent composés pendant les années 1872-73, une période d’exil volontaire dans les Ardennes, en Belgique puis en Angleterre. Verlaine (29 ans), ayant délaissé sa femme Mathilde et leur enfant, vit en compagnie de Rimbaud (17 ans) une relation passionnelle tumultueuse (qui le mènera quelques mois plus tard à tirer deux coups de revolver sur son compagnon, et à être condamné par la justice belge à deux ans de prison). Ces ariettes font écho à une période d’exaltation et de doute, où affleure parfois un tiraillement entre l’aspiration à une vie rangée, bourgeoise et la tentation de l’errance amoureuse et de l’aventure poétique…
Le titre. Il est emprunté au domaine musical où l’ariette (arietta = petit aria) désigne un air léger utilisé souvent dans les opéras-comiques et qui deviendra une forme poétique proche du rondeau. Ces « ariettes oubliées » seraient donc l’expression d’un état d’âme, d’une musique intérieure suscitée par des impressions (souvent sonores) dictées par des paysages ou des réminiscences personnelles.
- Le vent dans la plaine
A la tombée du jour, le chant des oiseaux dans les feuillages réveille des voix intérieures qui murmurent la vigueur et la fraîcheur de la passion amoureuse, à l’image des « frissons des bois », de « l’herbe agitée » ou du « roulis » des cailloux »… mais, à l’opposé de cette « extase », ce « chœur des petites voix » révèle aussi une sourde fêlure, une « plainte » partagée…
- Je devine, à travers un murmure
Cette ariette est rythmée par un constant balancement (à l’image de « l’escarpolette ») entre passé et avenir, (« voix anciennes » et « aurore future », « jeunes et vieilles heures »), qui laisse le poète désemparé, ballotté sans doute entre l’attachement à Mathilde et son aventure avec Rimbaud. Son présent n’est plus qu’« un jour trouble » où se profile la tentation de la résignation (« Ô mourir »…)
- Il pleure dans mon cœur
« Il pleure /il pleut » : ce parallèle entre les larmes et la pluie exprime « la langueur », la mélancolie du poète tenté de s’abandonner avec une certaine complaisance au « doux chant » de la pluie… Il esquisse toutefois un mouvement de révolte (ce profond ennui, ce « deuil » est d’autant plus douloureux qu’il s’avère être « sans raison » !) avant de céder finalement à l’abattement…
- Il faut, voyez-vous, nous pardonner les choses
Ce pardon des « choses » qu’implorent ces deux « âmes sœurs » pourrait tout aussi bien concerner son abandon coupable de Mathilde (afin de retrouver la vie rangée qui précéda l’exil) que son aventure homosexuelle en compagnie de Rimbaud (afin d’obtenir l’indulgence de la société bien-pensante à l’égard de cette transgression). Quoi qu’il en soit, dans cet exil, ces « deux pleureuses » aspirent à partager un bonheur innocent et à se soustraire au regard d’autrui, « loin des femmes et des hommes ».
- Le piano que baise une main frêle
La première strophe évoque une réminiscence où se mêlent des sensations tactiles (« baise, main ») olfactives (« boudoir parfumé »), visuelles ( « luit, soir rose et gris ») et auditives (« bruit d’aile, air charmant ») et où se dessine « vaguement » une présence féminine dans un salon mondain… Et le poète de s’interroger, dans la seconde strophe, sur la signification de ce souvenir fugace, de cette apparition fugitive, de ce « refrain incertain » qui l’interpelle… avant de s’évanouir dans « le petit jardin ».
- C’est le chien de Jean de Nivelle
En rupture avec la tonalité des autres poèmes, cette ariette s’apparente à un pot-pourri et présente un collage imaginaire (onirique ?) de figures fantaisistes où se côtoient des personnages empruntés au théâtre (François-les-bas-bleus), à l’imagerie historique (Jean de Nivelle, la Ramée) et à la culture populaire (la mère Michel, Lustucru)… S’en suit une farandole grotesque où la boulangère trompe son mari Lustucru avec le soldat la Ramée, où la belle « en robe bleue » tout en « frou-frou » portée en luxueuse chaise, chasse devant elle tous les manants, tous les « petits », qu’ils soient abbé… ou poète ! Auto-dérision de celui qui s’obstine à rechercher « la rime non attrapée ». Et quand tombe « la vraie nuit », François-les-bas-bleus s’esquive, en une ultime pirouette…
- Ô triste, triste était mon âme
Dans un dialogue lyrique entre le « cœur » (les sentiments) et l’«âme» (la raison), le poète chante à la fois l’absence de la « femme » et le choix de l’exil : éloigné de Mathilde , son « cœur trop sensible » cherche en vain la consolation, tandis que son « âme » déplore, sans le comprendre, ce « piège » paradoxal d’être « présents bien qu’exilés »…
- Dans l’interminable/Ennui de la plaine
Les six quatrains de cette ariette composent, tel un tableau impressionniste, un paysage hivernal (« neige, bises ») aux contours flous (« plaine, nuées, flottent, buées ») et aux couleurs délavées (« cuivre, sans lueur, chênes gris ») présentant quelques rares traces d’une vie chancelante (« corneille poussive, loups maigres »). Reflet de la détresse d’un poète en proie à l’« ennui » et à l’incertitude (« neige incertaine », flottent les chênes ») , voire au désespoir : le ciel cuivré est comme un couvercle qui lui refuse toute « lueur » ; son âme est un désert (« comme du sable ») et ne voit d’autre perspective que la déchéance (« quoi donc vous arrive ? ») et la mort (« on croirait voir mourir la lune »).
- L’ombre des arbres dans la rivière embrumée
Cette dernière ariette emprunte son thème à un poète du XVIIème siècle : Cyrano de Bergerac représente la condition du poète à travers la métaphore d’un rossignol qui, perché sur une branche, voit son reflet dans la rivière et croit s’y noyer… Verlaine substitue au chant du rossignol la plainte des « tourterelles » qui, dominant « parmi les ramures » les bords d’une rivière triste et moribonde (« meurt, blême, ombre, embrumée, fumée») voient dans leur propre reflet l’expression de leur désespoir et la mort de leurs espérances. Le poète semble toutefois être résigné à accepter ce renoncement et c’est donc sur une image apaisée que se concluent ces Ariettes oubliées…
Pierre Chevrier